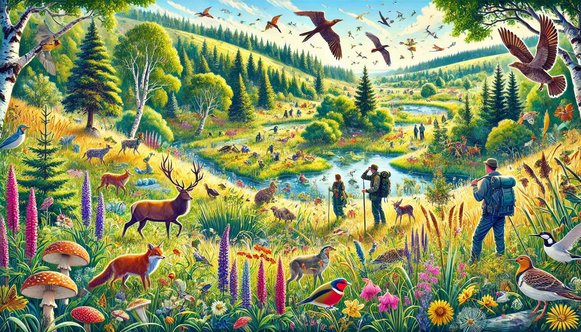

La Biodiversité
Vous avez envie de vous investir afin de favoriser les zones vertes et la biodiversité dans votre commune ?
Le meilleur moyen est de vous impliquer afin d’agir auprès de tous vos élus et sur les règlements en matière d’urbanisme et devenir un acteur actif.
Nous pouvons, avec l’expérience acquise sur la ville de Liège, vous aider à comprendre et à faire modifier les règles applicables à votre propre commune, à agir auprès de vos élus, à rendre votre commune plus verte et à être un acteur actif de la biodiversité chez vous. Nos expériences ne pourront que nous enrichir les uns les autres.
Nous pouvons aussi vous proposer des actions directes à mettre en place sur le terrain
Contactez le Groupe biodiversité urbaine GSM : 0491/87.67.31 ou par mail : André Lhoute
Définition de la biodiversité
La biodiversité est un concept qui désigne l’ensemble des êtres vivants sur Terre ainsi que les écosystèmes dans lesquels ils vivent.
Tous les processus, les modes de vie ou les fonctions qui conduisent à maintenir un organisme à l'état de vie sont étudiés par la science, c'est la diversité biologique.
La survie de l’homme dépend de son environnement. Son bien-être est lié à la satisfaction de besoins fondamentaux grâce à une biodiversité florissante.
Les humains ont besoin d'écosystèmes naturels qui permettent le maintien de la qualité de l’air, la régulation climatique, la purification de l’eau, la lutte contre les maladies et les parasites, la pollinisation, la prévention des érosions
Depuis 1900, l'abondance moyenne des espèces dans la plupart des grands biomes terrestres achuté de 20%, affectant les contributions de la nature aux populations. Ce phénomène pourrait s'accélérer.
Plus de 2 milliards de personnes utilisent du bois de chauffage pour répondre à leurs besoins primaires en énergie, environ 4 milliards se soignent principalement avec des remèdes naturels, et quelque 70 % des médicaments utilisés pour traiter les cancers sont des produits naturels ou des produits de synthèse inspirés par la nature.
Les systèmes alimentaires sont fortement dépendants de la biodiversité.
Plus de 75 % des cultures alimentaires mondiales, qui comprennent des fruits et légumes et quelques-unes des principales cultures commerciales, telles que le café, le cacao et les amandes, reposent sur la pollinisation animale.
Des pans entiers de nos économies dépendent également de la biodiversité. C'est pourquoi, la perte de biodiversité a des effets néfastes sur plusieurs aspects du bien-être humain, tels que la sécurité alimentaire, la vulnérabilité face aux catastrophes naturelles, la sécurité énergétique et l’accès à l'eau propre et aux matières premières. Elle touche également la santé, les relations sociales, le bien-être et la liberté de choix.
Les menaces sur la biodiversité
Les ressources naturelles ne sont pas infinies et pourtant depuis la révolution industrielle l'humanité les exploite comme telles. De ce fait, tous les écosystèmes ont été grandement transformés par les activités industrielles, agricoles et autres.
L'ampleur de la crise de la biodiversité a des causes nombreuses qui entraine la disparition du vivant :
La déforestation, depuis 2000, les forêts primaires ont perdu 6 millions d'hectares par an;
La disparition des habitats naturels (forêts, récifs coralliens, zones humides...);
La surexploitation du vivant (chasse et surpêche);
La pollutions industrielles et agricoles;
L’extension des villes et des infrastructures de transport;
La destruction des paysages;
L’introduction d'espèces invasives...
Quelles solutions pour sauver la biodiversité ?
5 causes d'origine humaine responsable de la 6e extinction de masse qui font desHommes la cause et les victimes de cette crise biologique :
1. la destruction des habitats naturels
2. les espèces envahissantes
3. la pollution
4. le changement climatique
5. la surexploitation des espèces
Gestes durables au quotidien
Des pistes pour agir collectivement ou individuellement :
A table...
Je choisis les fruits et légumes locaux et je redécouvre les anciennes variétés.
Je privilégie les produits issus de l'agriculture biologique, qui est plus respectueuse de l'environnement et des sols.
Je ne mange pas les espèces de poissons menacées d’extinction (thon rouge, cabillaud, sole, merlu…) et je privilégie le poisson issu d’élevages qui respectent l’environnement et favoriser la pêche à la ligne.
Mettre à l’honneur les poissons locaux et les poissons de saison. Les petits poissons, à préférer aux gros poissons
Je diminue ma consommation de viande que j'achète localement. Je privilégie un système d'élevage qui a recours au pâturage. Je diminue la quantité au profit de la qualité.
Dans la maison...
Quand j’achète des meubles (ou autres produits) en bois, je choisis du bois issu d’une exploitation durable, certifié FSC ou PEFC ou mieux encore, en bois indigène certifié.
J’évite la mode des animaux de compagnie exotiques (poissons, serpents, araignées, tortues, perroquets…).
Au jardin...
J’évite l’achat et l’utilisation d’engrais chimiques dans le jardin et les remplace par de l’engrais naturel fabriqué en compostant les déchets organiques et les déchets verts du jardin.
J’évite l’achat et l’utilisation de produits dangereux comme les herbicides, insecticides ou fongicides dans la maison. Il y a toujours des solutions non chimiques.
J’observe les espèces (par exemple, les oiseaux) et apprends à les identifier. Ainsi je peux aussi participer au recensement des espèces sauvages organisé annuellement par certaines associations.
Je transforme mon jardin en zone de biodiversité. Par exemple, en plantant une haie ou un verger (avec d'anciennes variétés d'arbres fruitiers) ou en accueillant des herbes et fleurs sauvages dans une partie du jardin.
J'accueille les animaux (oiseaux, insectes, rongeurs, batraciens...) en installant des abris ou une mare. Et j'évite surtout les plantes exotiques.
Mon balcon peut devenir une zone verte, en y installant des bacs à fleurs (espèces indigènes), des refuges pour insectes, une mangeoire pour oiseaux (en hiver!)...
Pour mes loisirs ou en vacances...
Quand je me promène dans la nature ou en forêt, je reste sur les chemins balisés pour éviter de piétiner les zones de végétation, je ne cueille pas les plantes, je ne retourne pas les pierres ou souches d’arbres en décomposition, je laisse les animaux tranquilles, j’évite de faire du bruit.
Pendant les vacances, je peux participer à un chantier de gestion de la nature (création ou entretien d’un parc naturel, observation ou comptage d’espèces menacées…) chez moi, ou à l’étranger.
En vacances, je préfère l’éco-tourisme ou le tourisme durable au tourisme de masse, qui menace souvent les écosystèmes locaux. Je visite les parcs naturels (tout en respectant les règles de bonne conduite) afin de soutenir la création de zones refuges pour la biodiversité. Je respecte la population locale et sa culture. Je n’achète pas de souvenirs fabriqués à partir de plantes ou d’animaux (coquillages, coraux, tortues…).
Les Journaux
RTBF
24 févr. 2025
Plus de 4 Belges sur 5 préoccupés par la biodiversité, selon le SPF Environnement
Plus de 4 Belges sur 5 sont préoccupés par la biodiversité. Ce sont les résultats du Baromètre de la biodiversité publiés lundi par le Service public fédéral de la Santé publique, de la Sécurité de la chaîne alimentaire et de l’Environnement.
Selon 79% des 1936 personnes interrogées en 2024, la biodiversité mondiale est en mauvais état, voire dans un état alarmant. 71% sont modérément à très préoccupées à cet égard.
La majorité des sondés (88%) sont convaincus que la perte de biodiversité affectera leur vie, mais seulement un tiers d’entre eux (32%) s’attendent à ce que cela ait un effet "important".
Ce sont les femmes, les jeunes de moins de 34 ans et les personnes ayant suivi des études supérieures qui sont les plus sensibilisés à la biodiversité.
Les connaissances des Belges sur la diversité des espèces sont en moyenne plutôt limitées aux différentes espèces animales, souligne le baromètre.
De nombreuses personnes considèrent la perte de biodiversité comme un problème qui concerne principalement les générations futures et les pays lointains. En moyenne, les Belges sont peu conscients de l’impact de la perte de biodiversité dans leur propre environnement. Ils ne réalisent pas toujours non plus que la biodiversité est une barrière contre le changement climatique, la pollution, la surexploitation ou encore l’apparition de maladies d’origine animale.
De nombreuses personnes contribuent déjà à la biodiversité en économisant l’eau et l’énergie, en cuisinant des plats à base de plantes, en achetant des vêtements d’occasion ou en menant des actions de volontariat en faveur de la nature.
D’autres éprouvent un sentiment d’impuissance et ignorent ce qu’elles pourraient faire.
La COP Biodiversité reprend ses travaux, à Rome, du 25 au 27 février 2025.
Le Monde
COP16 sur la biodiversité : à Rome, un accord arraché de justesse pour réformer le financement de la sauvegarde de la nature
Au troisième et dernier jour des prolongations de la 16ᵉ conférence mondiale sur la biodiversité, les pays riches et le monde en développement se sont résignés à des compromis mutuels pour adopter un plan de travail sur cinq ans.
Le Monde avec AFP Publié le 28 février 2025 à 00h03, modifié le 28 février 2025 à 01h25
Les délégués arrivent dans la salle de plénière pour la COP16 des Nations unies sur la biodiversité, au siège de l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) à Rome, le 25 février 2025. ALBERTO PIZZOLI / AFP
Un nouveau fiasco pour le multilatéralisme environnemental a été évité de justesse. Quatre mois après un échec retentissant en Colombie, les pays du monde ont arraché, jeudi 27 février à Rome, un compromis délicat sur le financement de la sauvegarde de la nature.
Au troisième et dernier jour des prolongations de la COP16 des Nations unies sur la biodiversité, les pays riches et le monde en développement se sont résignés à des compromis mutuels pour adopter un plan de travail sur cinq ans, censé débloquer les milliards nécessaires pour stopper la destruction de la nature et mieux distribuer l’argent aux pays en développement.
De longs applaudissements des délégués des quelque 150 pays ont accueilli le coup de marteau de Susana Muhamad, la ministre colombienne de l’environnement qui présidait cette 16e conférence de la Convention sur la diversité biologique (CBD).
« Nous avons accompli l’adoption du premier plan mondial pour financer la conservation de la vie sur Terre », a-t-elle déclaré triomphalement sur X.
« Nos efforts montrent que le multilatéralisme peut être porteur d’espoir dans une période d’incertitude géopolitique », a déclaré son homologue canadien, Steven Guilbeault, devant les quelque 150 pays présents à la FAO (Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture).
Cet accord permet, selon Susana Muhamad, « d’écraser un peu le fantôme de Cali » : la plus grande COP sur la biodiversité, avec 23 000 participants au bord de la jungle colombienne, s’était terminée sans accord le 2 novembre, faute de quorum après une nuit blanche de disputes.
200 milliards de dollars par an d’ici 2030
« J’annonce que nous avons donné des bras, des jambes et des muscles » à la feuille de route de Kunming-Montréal, par laquelle les pays se sont engagés en 2022 à réaliser 23 objectifs pour stopper la destruction de la nature d’ici 2030. Le plus emblématique de ces objectifs vise à placer 30 % des terres et mers dans des aires protégées (contre respectivement 17 % et 8 % actuellement, selon l’ONU).
Jeudi soir, les pays ont aussi adopté des règles et des indicateurs fiables censés mesurer et vérifier à la COP17, prévue en 2026 en Arménie, quelle est la réalité de leurs efforts. « Nous avons donné des bras, des jambes et des muscles » à cette feuille de route, s’est félicitée Susana Muhamad.
Rester à financer la tâche : un autre objectif fixe à 200 milliards de dollars par an d’ici 2030 les dépenses mondiales de protection de la nature, dont 30 milliards fournis par les nations développées aux pays pauvres (contre environ 15 milliards en 2022). Or c’est sur la manière de lever ces milliards, puis de les distribuer, que les pays se déchirent.
L’accord arraché à Rome renvoie à la COP de 2028 le soin de décider s’il faut créer un nouveau fonds placé sous l’autorité de la CBD, comme le réclament avec force les pays africains. Ou si les instruments existants, comme le Fonds mondial pour l’environnement (GEF en anglais), peuvent être réformés pour être plus accessible et équitable pour les pays en développement.
Les pays riches – menés par l’Union européenne, le Japon et le Canada en l’absence des Etats-Unis, non-signataires de la convention – sont hostiles à la multiplication des fonds, craignant une fragmentation de l’aide au développement. Ils réclament aussi un élargissement de la liste des pays tenus de fournir de l’aide au développement, afin d’intégrer les puissances émergentes comme la Chine. La question sera examinée par le plan quinquennal adopté à Rome.
Malgré l’échec sur la finance, la COP16 à Cali avait enregistré quelques décisions notables : l’une permettant une participation plus active des peuples autochtones au processus, l’autre créant un « Fonds Cali », destiné à distribuer une petite part des immenses bénéfices réalisés par des entreprises des pays riches grâce aux plantes ou aux animaux prélevées dans le monde en développement.
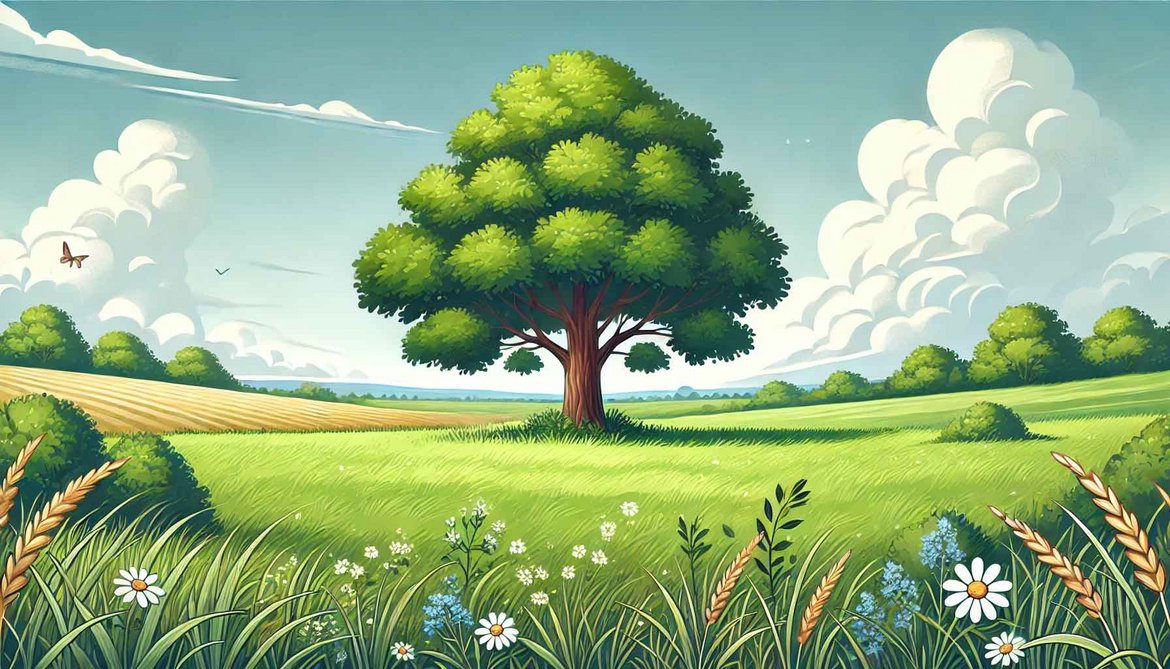
Protéger Arbres et Haies en Wallonie
(Code du développement Territorial - Codt article D.IV.4.12)
Tout citoyen qui le désire peut demander de classer un arbre ou une haie comme remarquable.
L’intérêt est que ce classement ne met pas cet arbre ou haie totalement à l’abri, mais lui donne un statut de protection plus important. Toute modification de leur silhouette ou toute intention d’abattage sont soumises à une autorisation délivrée par le Collège Communal après consultation des services du département de la Nature et des Forêts du Service Public de Wallonie.
Par ailleurs, tout autre projet d’abattage d’arbre ou de haie qui ne serait pas considéré comme remarquable au sens du CoDT ou tout projet qui pourrait porter atteinte à leur système racinaire peut nécessiter de demander un permis d’urbanisme préalable en vertu de la réglementation communale (voir « Plan Canopée » de Liège).
D’abord vérifier que l’arbre n’est pas déjà classé sur
Sont considérés comme étant remarquables
Les arbres et arbustes qui, en groupe ou en allée, présentent un ou plusieurs des critères suivants : intérêt paysager, historique, dendrologique, folklorique ou religieux, de curiosité biologique, taille exceptionnelle ou le fait qu’ils constituent un repère géographique, sur des listes établies conformément à l’article R.IV.4-9, pour autant qu’ils soient visibles dans leur entièreté depuis un point de l’espace public et qu’il s’agisse :
- d’arbres à haute tige dont le tronc mesuré à cent cinquante centimètres du sol présente une circonférence de minimum cent cinquante centimètres
- d’arbustes dont le tronc mesuré à cent cinquante centimètres du sol présente une circonférence de minimum septante centimètres
- de groupes d’arbres comportant au moins un arbre conforme au point
- de groupes d’arbustes comportant au moins un arbuste conforme au point b). (Ne sont pas concernés les arbres constitutifs de boisement ou d’alignements destinés à une exploitation sylvicole ou à l’agroforesterie) -
- d’arbres fruitiers aux conditions cumulatives suivantes :
- menés en haute-tige ;
- appartiennent à une des variétés visées à l’article 8 de l’arrêté du 8 septembre 2016 relatif à l’octroi de subventions pour la plantation d’une haie vive, d’un taillis linéaire, d’un verger et d’alignement d’arbres ainsi que pour l’entretien des arbres têtards ;
- font partie d’un verger comptant un minimum de quinze arbres fruitiers ;
- leur tronc mesuré à cent cinquante centimètres du sol présente une circonférence de minimum cent centimètres.
Les haies qui respectent les conditions de l'article sont d’office considérées comme étant remarquables :
- les haies répertoriées pour leur intérêt paysager, historique, dendrologique, folklorique ou religieux, de curiosité biologique, leur taille exceptionnelle ou le fait qu’elles constituent un repère géographique, sur des listes établies conformément à l’article R.IV.4-9
- les haies d'essences indigènes plantées depuis plus de trente ans sur le domaine public de la voirie.
Comment proposer l’inscription dans la liste officielle des arbres remarquables ?
En ouvrant le formulaire et en le replissant.
Ce formulaire ainsi que la localisation précise de l'arbre/haie sur un fond de carte IGN, est à retourner à l'adresse suivante
Ministère de la Région Wallonne
Direction Générale des Ressources Naturelles et de l’Environnement
Division de la Nature et des Forêts
Avenue Prince de Liège, 15
5100 JAMBES
Adresse du site Région Wallonne : Démarches pour protéger des arbres et des haies en Wallonie

Observez la Nature
Observation.be
Vous adorez vous balader dans la nature et faire des observations de toute nature, aidez-nous à mieux la protéger.
Lorsque vous observez des espèces protégées, y compris en ville, et que vous voulez aider la nature, enregistrez vos observations sur observation.be.
Cela nous permet, en cas de projet urbanistique sur votre lieu d’observation, de pouvoir mieux protéger le site.
Pour ajouter des observations, vous devez avoir un compte sur observations.be. Si vous avez déjà un compte, vous pouvez vous connecter ci-dessous Sinon, veuillez d'abord créer un compte.
Soumettre l'observation - Observation.be
Extrait du site natagora
Dès 1966, un réseau d’observateurs s’organise afin de centraliser les observations ornithologiques (à l’époque sous forme de fiches papier) en Wallonie et à Bruxelles. Les données sont mises à disposition des scientifiques pour orienter leurs actions de conservation.
En 2008, en collaboration avec Natuurpunt, Natagora décide d’informatiser le système et d'utiliser le portail observations.be. Le portail, accessible à tous, permet de récolter des informations précieuses d’un grand nombre de naturalistes belges. Les données sont directement partagées, analysées, et mises en ligne.
DES DONNÉES LARGEMENT UTILISÉES
Les informations sont utilisées par de nombreux acteurs de la conservation de la nature. Depuis 2008, plus de 560 demandes proviennent d’acteurs aussi variés que des bureaux d’études d’incidence sur l’environnement, des universités, des administrations, des asbl ou des particuliers. Ces données sont particulièrement utiles au sein de Natagora pour évaluer les mesures de gestion ou suivis d’espèces.
Antoine Derouaux, ornithologue chez Natagora :
"Un exemple d’utilisation concrète des données concerne la mise en place de mesures de protection des oiseaux sur les lignes à haute tension gérées par Elia. Grâce aux milliers de données disponibles, les zones les plus dangereuses ont été mises en évidence. Des visites des lignes dangereuses ont été menées et les zones prioritaires commencent à être équipées de balises qui diminuent les risques de collision en rendant les câbles plus visibles."
LES SCIENCES CITOYENNES VERSION SMARTPHONE
Rapidement, des applications ont été développées pour permettre aux observateurs de saisir leurs observations directement sur le terrain.
Depuis 2017, plus de la moitié des données arrivent par ce canal. L’observateur gagne du temps d’encodage et de la précision, grâce au GPS. Gratuites, les applications ObsMapp ou iObs permettent d’encoder les observations quotidiennes.
D’autres applications permettent la reconnaissance en direct d’espèce, et leur encodage immédiat dans la banque de données. Les sciences citoyennes 3.0 sont en route.
Soutenez Natagora
Vous aimez la nature ? Aidez-la !
Participez avec Natagora à la préservation de l’environnement en Wallonie et à Bruxelles. Apportez votre voix à la nature en devenant membre de Natagora et soutenez activement nos actions en rejoignant notre groupe de volontaires.
Faire un don
Vos dons rendent possibles toutes les actions de notre groupe de volontaires en faveur de la biodiversité. Déductibilité fiscale à partir de 40 € de dons par an.
JE PARTICIPE